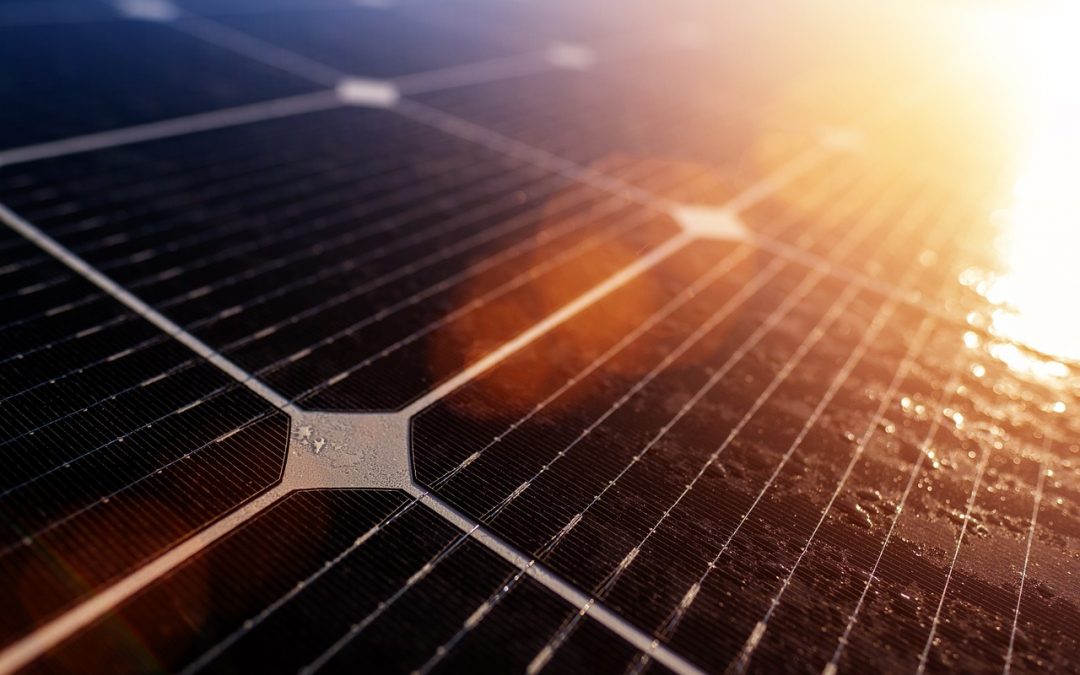Ils n’ont pas de cerveau. Pourtant, nous pourrions avoir bien des enseignements à tirer des stratégies mises en place par les bénitiers géants pour transformer l’énergie qu’ils reçoivent du soleil.
Le bénitier géant, c’est le plus gros mollusque bivalve que les scientifiques connaissent. Et il est en danger d’extinction. Ce n’est pourtant pas pour cela que des chercheurs de l’université de Yale (États-Unis) se sont intéressés à lui. Mais plutôt dans l’espoir d’en apprendre un peu plus sur la manière dont cette étonnante palourde convertit la lumière du soleil en énergie utile. De manière finalement plus efficace que n’importe quelle technologie de panneaux solaires existante.
L’équipe a déjà réalisé une série de travaux visant à mettre en évidence des mécanismes biologiques qui pourraient inspirer de nouveaux matériaux plus durables. Dans la revue PRX : Energy, les chercheurs racontent cette fois comment ils ont étudié l’impressionnant potentiel à exploiter l’énergie solaire des bénitiers géants irisés dans les eaux peu profondes des Palaos, dans le Pacifique occidental.
Le secret du bénitier géant pour exploiter la lumière du soleil
Rappelons que le bénitier géant est ce que les chercheurs appellent photosymbiotique. Comprenez que pour assurer sa production d’énergie à partir de la lumière du soleil, il vit en symbiose avec un autre organisme. En l’occurrence, des algues unicellulaires assemblées en cylindres verticaux qui poussent à la surface du bénitier. Ces algues absorbent la lumière du soleil après qu’elle a été diffusée par une couche de cellules appelées iridocytes. Et il semblerait que la disposition en colonnes verticales de ces algues leur permette d’absorber la lumière du soleil au rythme le plus efficace. Une fois filtrée et diffusée par la couche d’iridocytes, la lumière s’enroule en effet uniformément autour de chaque cylindre d’algues.
Sur la base de la géométrie particulière des bénitiers géants, les chercheurs ont donc développé un modèle pour calculer l’efficacité avec laquelle chaque photon est converti en un électron. Un modèle qui tient également compte des fluctuations de lumière au cours d’une journée sous les tropiques. Résultat : 42 %. Plutôt pas mal lorsque l’on sait que l’efficacité en la matière des feuilles vertes n’est que d’environ 14 %.
Doper l’efficacité des panneaux solaires
Le plus intéressant, c’est que lorsqu’ils ont intégré à leur modèle une particularité du bénitier géant, le chiffre a bondi à… 67 % ! La particularité en question : la manière dont les palourdes s’étirent en réaction aux changements de lumière solaire, rendant les colonnes d’algues plus ou moins courtes et larges. Les chercheurs rapportent que le phénomène s’observe aussi sur les forêts boréales d’épicéas. Avec leurs couches fluctuantes de brouillard et de nuages, elles partagent des géométries et des mécanismes de diffusion de la lumière similaires à ceux des bénitiers géants, mais à une échelle beaucoup plus grande. Et leur efficacité s’avère presque identique.
Comment ces découvertes pourraient-elles s’appliquer à la production d’électricité renouvelable ? En imaginant une nouvelle génération de panneaux solaires incluant des algues ou à partir de matériaux qui changent de forme en réaction à la lumière du soleil. Parce que l’efficacité de nos panneaux photovoltaïques d’aujourd’hui, quant à elle, ne dépasse guère les 20 % !